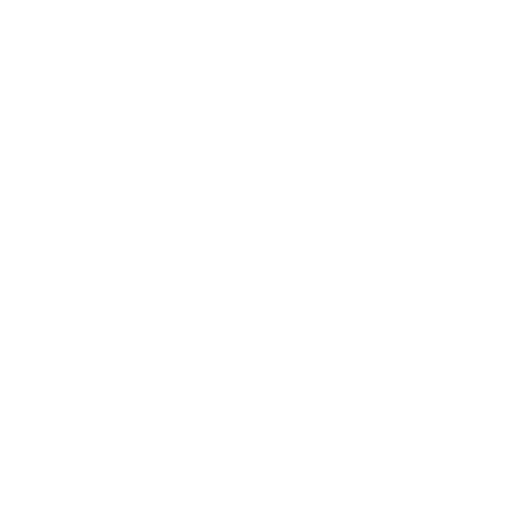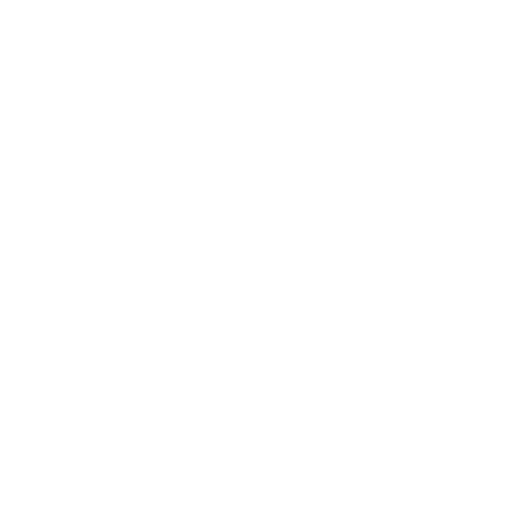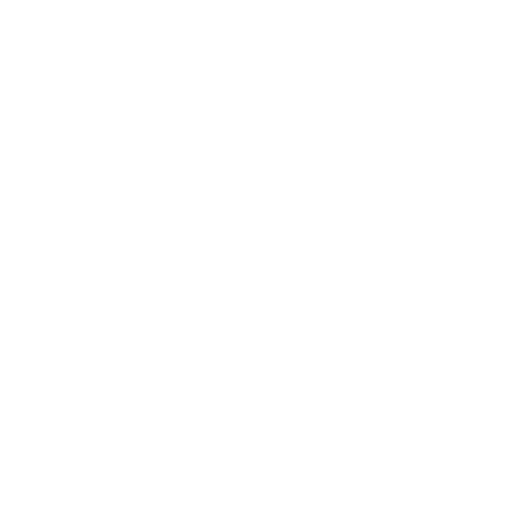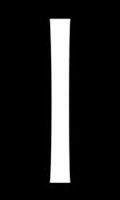

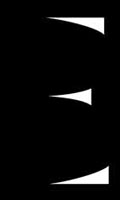

Présentation de l’exposition
« Je ne fais pas de photos d’archéologie. Je photographie le paysage qui surgit ou pourrait disparaître sous la menace du temps, qui est cependant toujours là ; ce paysage originaire de nos cultures d’Europe.»
Josef Koudelka, extrait de Rencontre, texte de Bernard Latarjet dans le catalogue de l’exposition Ruines
Pour beaucoup, le nom de Josef Koudelka reste inéluctablement lié à ses clichés emblématiques de l’invasion de Prague par les troupes soviétiques en 1968, publiés de façon anonyme par peur des représailles. Quittant la Tchécoslovaquie en 1970, longtemps apatride, Josef Koudelka a construit au fil de ses sujets photographiques son mythe du photographe aux semelles de vent, soucieux de rendre compte de la perte des références culturelles d’une communauté (Gitans, Exils). Il trouve en France une terre d’accueil et des amis parmi lesquels Henri Cartier-Bresson avec qui il travaille au sein de l’agence Magnum, Robert Delpire qui publia le premier ses séries, Xavier Barral qui prit le relais et Bernard Latarjet pour lui proposer de participer à la mission photographique de la DATAR, grande traversée des paysages de la France des années 80.
C’est à la faveur de cette mission puis d’autres qui suivront – Transmanche, Conservatoire du littoral... - que Josef Koudelka va systématiser le choix du format panoramique et en faire sa signature pour les photographies de paysage.
À partir de 1991, il s’intéresse aux paysages en ruines qui deviennent un de ses sujets de prédilection.
De la ruine antique à la ruine de guerre à Beyrouth en passant par les vestiges de l’Empire soviétique
qu’il photographie alors qu’il est invité sur le tournage du film d’Angelopoulos Le regard d’Ulysse, l’idée
du désordre du monde l’habite, comme le montre son ensemble de panoramiques publiés sous le titre
Chaos.
Constatant une rupture de l’homme avec son contexte civilisationnel, il se tourne vers les lieux de la
Méditerranée, substrats d’une culture européenne. Pendant près de trente ans, il traverse 20 pays et
photographie environ 200 sites archéologiques, selon un protocole invariable. Du printemps jusqu’à
l’hiver, il voyage dans ces lieux et capture colonnes tombées à terre ou toujours dressées, ombres
franches qui découpent la géométrie des ruines et marbres éblouissants de soleil... L’hiver, il fait des
tirages d’étude, les analyse, les sélectionne méthodiquement pour livrer selon ses termes son « maximum
», ses meilleures images, les plus intenses, celles qui résisteront à l’air du temps pour entrer dans le
temps de l’art.
« Les ruines, ça n’est pas le passé, c’est l’avenir qui nous invite à l’attention et à la jouissance du présent. Tout en Europe est lié à la Méditerranée et tout, autour de nous, un jour, sera en ruine. »
Josef Koudelka, extrait de Rencontre, texte de Bernard Latarjet dans le catalogue de l’exposition Ruines
Le partage d’une expérience intime
L’exposition de la BnF témoigne de ce travail titanesque et révèle, outre sa maestria de photographe de
paysages, la singularité de Josef Koudelka, qui consiste à ne proposer ni un paysage d’histoire ni une
histoire du paysage mais un partage de son expérience intime du lieu. Dans la mission de la DATAR,
tout comme dans ses panoramiques de l’Europe du Nord ou de l’Est ou encore du mur entre Israël et la
Palestine, Josef Koudelka montrait l’éclatement de l’ordre millénaire des paysages au profit de territoires
industrialisés, découpés, meurtris, banalisés, de lieux devenus les signes d’un nulle part ou d’une impasse.
Avec Ruines, ses pérégrinations odysséennes l’ont conduit à sonder ce qui dans le fragment résiste
comme signe d’une totalité disparue. Dans une scénographie qui rappelle le parcours de visite d’un site
archéologique, les panoramiques verticaux et horizontaux de l’exposition se répondent avec une force
mémorielle qui semble renvoyer à la phrase de Prosper Mérimée : « Plus solide que les monuments, la
photographie ».
En refusant d’investir les codes traditionnellement attachés aux panoramiques – la vision englobante qui
place l’homme au centre, le regard parfaitement aligné sur l’horizon -, en renonçant au réconfort sublime
de la ruine romantique, Josef Koudelka opte pour des vues basculées, complexes, où s’architecture
néanmoins un désordre des ruines. Son regard étaie l’ensemble et construit ce qui reste à dire de la
beauté du monde.
Fragile et pourtant toujours là, trace pérenne et métaphore du temps qui passe, la ruine condense tous les
contraires. Servie par un noir et blanc contrasté, elle devient le motif photographique par excellence, celle
d’un émerveillement inquiet face à un paysage à la fois tourmenté et à la beauté sereine, d’où l’homme est
absent mais présent partout, en creux.
À cet égard, les paysages panoramiques de Ruines révèlent comme nulle autre série de Koudelka la dualité de son regard, solaire et grave, aérien et minéral, lyrique et implacable, tout à son sujet en ce qu’il semble faire sienne cette phrase d’Albert Camus face aux ruines de Tipasa : « il fallait retourner au combat avec cette lumière conquise ».