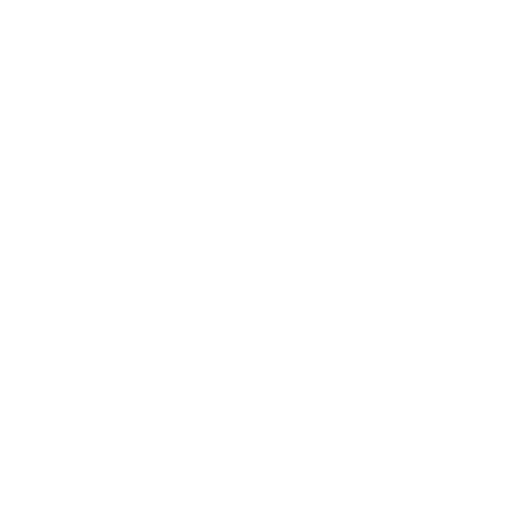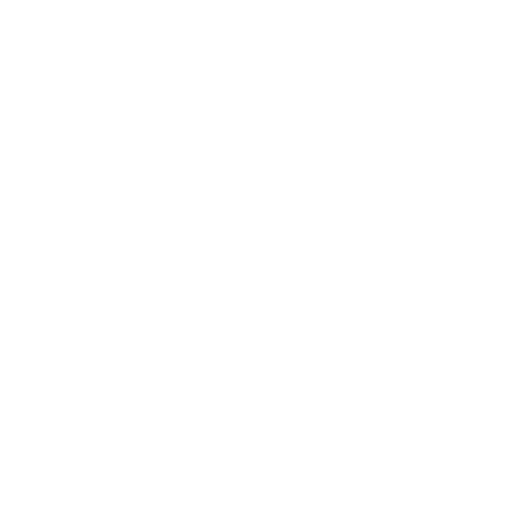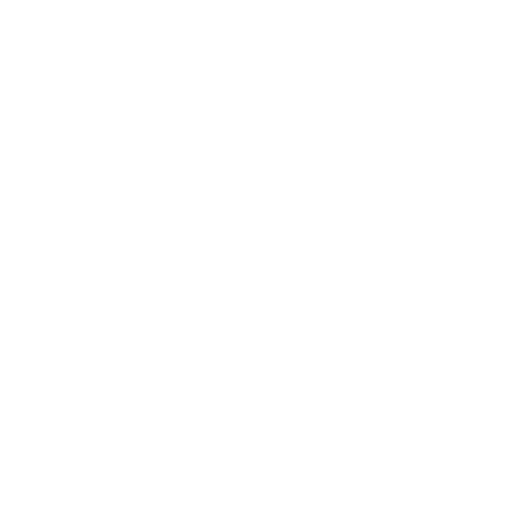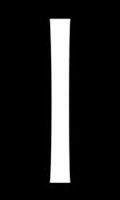

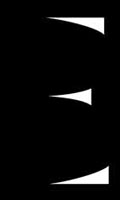

Biographie de Josef Koudelka
1938
Josef Koudelka naît en Moravie (actuelle République tchèque).
Vers 1952
Il est initié par un ami de son père, boulanger, à la photographie.
1956-1961
Il entreprend des études d’ingénieur à l’université technique de Prague.
1961
Il rencontre le critique Jiri Jenicek qui le pousse à montrer ses images. Il fait également connaissance avec Anna Fárová, critique d’art, qui devient une amie et une collaboratrice. Il commence à photographier les gitans de Tchécoslovaquie.
1961-1967
Il travaille comme ingénieur aéronautique à Prague et à Bratislava. Il contribue en tant que photographe indépendant au magazine Divadlo (Théâtre).
1965
Il devient membre de l’Union des artistes tchécoslovaques.
1967
Il démissionne de son poste d’ingénieur et se consacre désormais à la photographie. Ses photographies de Gitans sont présentées pour la première fois à l’exposition, Cikáni 1961-1966.
1968
Il réalise les prises de vue de l’invasion de Prague par les troupes soviétiques.
1969
Ce travail est publié anonymement puis récompensé par le Robert Capa Gold Medal Award, Overseas Press Club, États-Unis.
1970
Il quitte son pays natal, devient apatride et commence une vie d’exil qui le conduit en Grande- Bretagne. Il trouve asile en Angleterre où il réside jusqu’en 1979. Il commence à voyager et à photographier les Gitans, les fêtes religieuses et populaires, et la vie quotidienne dans différents pays d’Europe
1971
Il entre chez Magnum Photos et rencontre Henri Cartier-Bresson avec qui il se lie d’amitié.
1973
Il obtient une bourse du British Arts Council afin de photographier la vie des gitans au Royaume-Uni. Il rencontre Robert Delpire avec qui il commence à préparer son livre Gitans : la fin du voyage.
1975
Le Museum of Modern Art, New York lui consacre une exposition personnelle organisée par John Szarkowski. Aperture publie la version américaine de Gitans sous le titre Gypsies.
1977
Gitans : la fin du voyage est édité en France par Robert Delpire puis exposé successivement à la Galerie Robert Delpire à Paris ; à la Kunsthaus de Zürich ; au Museum of Art de Tel-Aviv ; au Victoria & Albert Museum de Londres.
1980
Il quitte l’Angleterre pour la France. Toujours apatride, il continue de voyager à travers l’Europe.
1984
La Hayward Gallery de Londres accueille la première grande exposition monographique de Josef Koudelka, organisée par l’Arts Council of Great Britain et conçue par Robert Delpire. Pour l’accompagner, le livre Josef Koudelka, dans la collection “Photo Poche”, est publié en anglais et en français par le Centre national de la photographie à Paris.
1986
Bernard Latarjet et François Hers l’invitent à participer à la Mission photographique de la DATAR. Josef Koudelka choisit alors d’utiliser un appareil panoramique pour photographier les espaces industriels et urbains du Nord de la France, de la Lorraine et de Paris. C’est sa première collaboration avec Bernard Latarjet.
1987
Il est naturalisé Français et reçoit le Grand Prix national de la Photographie, décerné par le Ministère de la Culture.
1988
Robert Delpire conçoit deux grandes expositions monographiques sur l’œuvre de Koudelka qui sont présentées au Palais de Tokyo, Centre national de la photographie, à Paris, et à l’International Center of Photography à New York. Elles circulent ensuite aux États-Unis et en Europe. Exils est publié par le Centre national de la photographie à Paris, par Aperture à New York et par Thames & Hudson à Londres.
1989
Il est invité par Pierre Devin à participer à la Mission photographique Transmanche dont les images sont publiées dans son premier livre de photographies panoramiques : Josef Koudelka, Mission photographique Transmanche, cahier n° 6.
1990
Il retourne en Tchécoslovaquie après vingt ans d’exil. Il commence à photographier l’Europe de l’Est. Il se sert notamment d’un appareil panoramique pour en représenter l’un de ses paysages les plus dévastés : la région des monts Métallifères du Nord de la Bohême, du Sud de l’Allemagne et de la Pologne, connue sous le nom de Triangle noir.
1991
Il obtient le Grand Prix Henri Cartier-Bresson en France. Cette même année, Josef Koudelka commence son travail photographique sur les ruines antiques des sites méditerranéens. Il photographie aussi avec un appareil panoramique le centre-ville de Beyrouth détruit par la guerre.
1994
Il accompagne l’équipe du film Le Regard d’Ulysse, réalisé par Theo Angelopoulos. Il donne une vision personnelle des pays des Balkans où se déroule le tournage. Ses photographies sont exposées et publiées sous le titre Periplanissis: Following Ulysses’ Gaze. Il publie son livre Triangle Noir.
1999-2001
Il publie Chaos aux éditions Delpire et expose cette série dans divers musées.
2001
Il produit une série de photographies panoramiques pour le groupe Lhoist, producteur de chaux, ce qui donne lieu à la publication du livre Limestone aux éditions de la Martinière.
2002
Une rétrospective lui est consacrée aux Rencontres internationales de la Photographie d’Arles, France et à la Galerie nationale de Prague, République tchèque.
2003
Il publie Teatro del Tempo, son projet photographique sur Rome.
2004
Il reçoit le prix Cornell Capa Infinity Award, International Center of Photography, États-Unis.
2006
Il est invité à photographier en panoramique les paysages de Camargue dans le cadre de la mission du Conservatoire du littoral.
2012
Il publie Lime aux éditions Xavier Barral, aboutissement d’un travail photographique conduit de 1999 à 2010 à la demande du groupe Lhoist, à travers 11 pays. Il est nommé Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres par le Ministère de la Culture.
2013
Il publie Wall : Israël-Palestine, paysage 2008-2012 aux éditions Xavier Barral. Il expose Vestiges 1991-2012 au Musée de la Vieille Charité à Marseille dans le cadre de Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture ainsi qu’au Pont du Gard en 2015 et à l’Abbaye de Jumièges en 2017. Il est invité par le Vatican à participer à la Biennale de Venise avec l’exposition de ses panoramas Decreazione au Pavillon du Saint-Siège.
2014
Une exposition rétrospective Josef Koudelka : Nationality Doubtful lui est consacrée à l’Art Institute of Chicago puis au J. Paul Getty Museum à Los Angeles.
2017
Il expose La Fabrique d’exils à la Galerie de photographies du Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou et publie aux éditions Xavier Barral La fabrique d’Exils.
2018
Une rétrospective Koudelka : Returning lui est consacrée au Musée des arts décoratifs et Decreazione à la Galerie nationale, à Prague.
2020
Il expose sa série Ruines à la Bibliothèque nationale de France. À cette occasion, la BnF co-édite avec les éditions Xavier Barral le livre de Josef Koudelka : Ruines.
Entretien
avec Héloïse Conésa
conservatrice au département des Estampes et de la photographie, commissaire de l’exposition
Pourquoi cet intérêt de Josef Koudelka
pour les ruines ?
H.C : La ruine est un leitmotiv dans l’œuvre de Koudelka, un marqueur important de son travail de
paysagiste. On retrouvait déjà les ruines du monde industriel du Nord de la France et de la Lorraine
dans ses images de la Mission photographique de la DATAR, dont la BnF conserve l’ensemble du fonds.
Dans la série Chaos, publiée aux éditions Delpire en 1999, la ruine était aussi présente dans un paysage
contemporain – celui des industries du « Triangle noir » d’Europe centrale jusqu’aux traces de la guerre
civile à Beyrouth - qui se livrait pourtant comme un « ailleurs » déserté, non daté, à peine situé. La ruine
du monde moderne, débarrassé de ses hommes, chaotique, marqué par les désastres, donnait le ton d’un
décor avant tout minéral, façonné par l’œil du photographe.
Je pense que trois facteurs principaux expliquent l’intérêt de Josef Koudelka pour les ruines : le rapport
singulier au temps qu’elles suggèrent, la réflexion sur une civilisation commune qu’elles imposent et enfin,
les possibles en termes de composition photographique qu’elles permettent.
Koudelka est un photographe de l’agence Magnum mais il a toujours refusé d’être considéré comme un
photoreporter engagé dans une course contre la montre avec le présent. La ruine est un motif sans âge
ou plutôt de tous les âges, à la fois intemporelle et a-temporelle, qui témoigne de ce rapport singulier du
photographe au temps – un rapport qui se défie autant de l’actualité que de la nostalgie face aux ruines.
Koudelka nous met en garde par rapport à une quelconque fascination romantique de la ruine et témoigne
qu’il n’y a pas de ruines éternelles : de nombreux sites photographiés ont changé de physionomie en
raison du tourisme ou de l’érosion naturelle ou encore ont subi des destructions.
Ce qui compte pour Koudelka, c’est d’entremêler les temporalités et, en ce sens, la ruine antique est
autant pour lui un retour aux sources qu’une méditation sur notre monde contemporain et une projection
dans un avenir possible. À ce titre, elle est le parangon d’une forme de chronologie verticale où toute
l’histoire des hommes et de la terre qu’ils habitent s’accumulerait par strates.
En quoi l’utilisation du panoramique
chez Koudelka est-elle singulière ?
H.C : Koudelka a fait usage du panoramique dès la fin des années 50 mais c’est sa collaboration à la
Mission photographique de la DATAR, initiée par Bernard Latarjet et François Hers en 1984, qui lui a
permis d’en systématiser l’emploi. Depuis, c’est devenu sa « signature » que l’on retrouve dans d’autres
séries comme Chaos, Wall ou encore Lime.
Traditionnellement, le format panoramique a été utilisé car il permet d’embrasser du regard tout un
paysage et place le spectateur en surplomb et au centre de la composition. C’était donc un formidable
outil de connaissance pour les archéologues, notamment au XIXe
siècle, afin d’envisager un site de fouilles
dans son ensemble. L’usage habituel du panoramique élargit le champ de vision et impose aussi une
certaine forme d’harmonie et de stabilité au regard.
Koudelka travaille le panorama à contre-emploi, en déjouant les codes et les attentes que l’on peut en
avoir. Ses panoramiques n’élargissent pas notre vision du site, ils découpent dedans, opèrent une forme
de carottage visuel qui le condense de façon essentialiste. Ils réunissent dans un seul regard des vues
lointaines et des gros plans, livrent une vision subjective du paysage avec des espaces éclatés, des visions
à fleur de sol, un bout d’arbre, un bout de pavement, un bout de colonne tombée à terre qui, d’un panora-
mique à l’autre, composent un autre paysage...
L’horizon est rarement présent dans ses panoramiques, peut-être parce que l’horizon confère à l’image un
sentiment de sécurité et marque aussi une sorte de frontière, une fin de la terre.
Quand il utilise le panoramique, Koudelka ne domine pas, n’utilise pas de trépied ce qui donne une image
très vivante, mobile. Le panoramique, tel qu’il l’utilise, rend manifeste les tensions, les désordres de ces
mondes qui se sont effondrés. Il bascule parfois ses images à la verticale afin de donner l’impression d’un
paysage morcelé, comme vu à travers une meurtrière.
Avec sa façon de photographier, très construite, Koudelka regarde la ruine pour ce qu’elle est, formellement,
en termes de volumes, de plans... Il agit avec son « œil de peintre », comme disait de lui Cartier-Bresson.
Pourquoi ce choix du noir et blanc ?
H.C : Koudelka n’est pas photoreporter et il n’a jamais fait de couleur sans doute en raison du rapport à
l’actualité, à une forme d’immédiateté du présent que celle-ci distille. Le noir et blanc est plus réflexif et
correspond à une volonté d’inscrire son travail dans le long cours, comme c’est le cas pour Ruines qui
l’occupe depuis presque trente ans. Pour des raisons techniques, il est plus difficile de préserver une
cohérence chromatique quand on travaille en couleur sur plusieurs années tandis que le noir et blanc
donne une unité visuelle à des images prises à des périodes différentes.
Faire le choix du noir et blanc, c’est aussi s’inscrire dans l’histoire des grands photographes qui se sont
tous illustrés à travers ce monochromatisme caractéristique de l’argentique. Toutefois, Koudelka n’est
pas, comme il le dit lui-même, « un nostalgique de l’argentique » et ces dernières années il a d’ailleurs
choisi pour ses prises de vues et tirages la technologie numérique dont il apprécie la grande qualité
désormais offerte. Il n’empêche que cette élection du noir et blanc l’inclut dans la lignée des grands
photographes « modernistes » de l’agence Magnum : Cartier-Bresson, Capa, Bischof, Erwitt...
Enfin, Koudelka travaille avec l’essence de la photographie, qui est la lumière, si importante en
Méditerranée. Tandis que la couleur parasite les jeux de valeurs primaires, le noir et blanc permet
de révéler cette dimension essentialiste et formaliste de la photographie : ce jeu d’ombre et de lumière,
de contrastes, qui jalonne toute l’œuvre de Koudelka.
Comment travaille Koudelka ?
Quel a été, en particulier, le processus de création de cette série Ruines ?
H.C : Koudelka a une grande rigueur dans son protocole de travail : de mars à septembre, il voyage,
il photographie. D’octobre à mars, il choisit les images qui trouveront leur place dans une série. Il alterne
ainsi une période de production et une période d’élection des images. Cette dernière est marquée par un
pacte exigeant de l’auteur avec son art : la bonne photographie est celle qui résistera au regard qu’il posera
sur elle pendant plusieurs mois à l’atelier ....
Josef Koudelka aime à dire qu’il recherche et s’intéresse à ce
« maximum » qu’il peut obtenir de lui et du contexte qui l’entoure pour réussir cette bonne photographie.
Pour Ruines, il lui a été parfois nécessaire de revenir sur les lieux : tenter de nouveaux cadrages, revoir
telle lumière sur une sculpture, une colonne etc. Ainsi pour une photographie qui le hantait sur le site de
Petra, en Jordanie, il est revenu plusieurs fois au fil des ans.
Dans le film Koudelka. Crossing the same river de Coskun Asar, qui sera en partie diffusé dans l’exposition,
on voit bien comment Koudelka photographie les sites antiques. Koudelka est un photographe-marcheur,
et son ressenti du lieu, de ses reliefs est très important. Cette inscription physique du photographe dans
le paysage est fondamentale et cela le rapproche des land artists : ce qu’il voit, c’est autant la ruine que
le paysage autour. Il arrive souvent sur les lieux avant le lever du jour, il les arpente inlassablement puis
il attend pour voir comment le lieu est révélé par la course du soleil au fil de la journée. D’une certaine
manière, la bonne photographie pourrait être celle qui vient redoubler cette épiphanie que constitue la
rencontre de la lumière et de l’ombre, du hiératisme minéral et de la vivacité végétale, de la nature et de
la culture.
Un dernier point qu’il convient de souligner est que Josef Koudelka en tant que photographe de l’agence
Magnum est aussi entouré par un ensemble de professionnels qui l’aident dans la production et la diffusion
de ses séries. Pour Ruines, le photographe a pendant des décennies organisé ses voyages soit de façon
autonome soit avec l’aide de Magnum qui trouvait parfois des partenaires dans certains pays qu’il voulait
visiter. A chaque retour de voyage, Josef Koudelka travaille par ailleurs avec Enrico Mochi qui gère,
numérote, archive les fichiers numériques pour Magnum, afin de fournir au photographe tout le matériel
qui lui permet de faire son éditing et in fine, de définir la forme de son projet.
Puis, pour l’exposition
proprement dite, Clarisse Bourgeois, en charge de la production, fait le lien entre Josef Koudelka et le
laboratoire PICTO qui fait les scans et les tirages. Elle est en quelque sorte « la traductrice » entre le
photographe et le tireur, Christophe Batifoulier, pour qu’ensemble ils trouvent le bon équilibre des plans
et des gris pour obtenir le tirage souhaité par le photographe. Enfin, nous avons aussi travaillé de concert
avec Andrea Holzherr qui coordonne les expositions pour Magnum et son adjointe Marion Schneider.
Quel a été le rôle d’Alain Schnapp ?
H.C : Alain Schnapp est un éminent archéologue qui a écrit un ouvrage de référence sur les ruines inti-
tulé Ruines - Essai de perspectives comparée (Éd. Les presses du réel, 2015) dans lequel il souligne que
« la ruine est ce qui reste d’une tension entre mémoire et oubli, permanence et impermanence, œuvre de
culture et action de la nature » et c’est cette tension même que les photographies de Josef Koudelka, en
particulier dans leur usage détourné du panoramique, expriment de manière sensible.
Les connaissances de l’archéologue, complétées par le travail de la chercheuse Valeria Tosti, ont permis
de donner un précieux complément d’informations sur la localisation exacte des ruines, l’histoire de ces
colonnes, de ces pavements, de ces fragments de sculptures photographiés par Koudelka, le contexte de
leur transformation en ruines et l’histoire de leur réception.
Le regard d’Alain Schnapp a apporté, notamment au sein du catalogue, une autre appréhension de l’œuvre
photographique de Josef Koudelka dont il a su mettre en évidence la filiation avec celle d’autres artistes –
écrivains, peintres, graveurs – qui ont pensé la ruine.
Mais la réciproque est vraie : le travail du photographe interroge aussi l’expertise du scientifique. Qu’est-
ce qu’un photographe voit qu’un archéologue ne perçoit pas ? En quoi sa vision, avant tout esthétique,
peut-elle nous permettre d’appréhender différemment ce qui est un objet d’études et de recherches ?
Cette confrontation des regards dans une exégèse contemporaine des ruines nous intéressait également
beaucoup parce qu’aujourd’hui certaines d’entre elles ont disparu à cause de l’érosion, des guerres
ou encore de l’industrie touristique. Certains sites ne sont plus visibles désormais tels qu’ils ont été
photographiés par Koudelka. En ce sens, cette série est aussi une œuvre de mémoire pour beaucoup
d’archéologues.
Quelle place tient cette exposition
dans le parcours de Koudelka ?
H.C : Cette exposition à la BnF est très importante pour Koudelka car le projet tel qu’il existe, avec le
catalogue, correspond à son souhait de présenter si ce n’est in extenso tout au moins la plus grande partie
de cette série, aboutissement d’un projet mené pendant près de trente ans.
Pour beaucoup, Koudelka demeure avant tout le photographe du Printemps de Prague, des Gitans et
d’Exils mais s’il est vrai que ces trois séries sont importantes, il avait à cœur de montrer aussi la place
prépondérante qu’occupe le paysage panoramique dans sa carrière de ces trente dernières années.
La BnF semblait l’institution adéquate pour en témoigner ne serait-ce que parce que nous conservions,
depuis la fin des années 80, les paysages panoramiques que le photographe avait faits dans le cadre de
la Mission de la DATAR.
Josef Koudelka, Bernard Latarjet et moi-même avons choisi les 110 œuvres exposées, tirées en grand
format, parmi les 171 photographies (de format 50 x 60) qui sont entrées dans les collections de la BnF
à la faveur du don majeur que le photographe lui a généreusement consenti. Certaines d’entre elles
avaient déjà pu être présentées dans des expositions, à Marseille ou à Jumièges, mais c’est la première
fois qu’autant de photographies de cette série sont réunies dans un parcours qui rend pleinement compte
de la dynamique de ce projet titanesque.
Chaque exposition est pour Josef Koudelka l’occasion de livrer
une nouvelle et singulière interprétation de son œuvre avec une scansion toujours pensée pour un espace
et un moment particuliers : ici, l’espace de la grande galerie de la BnF I Mitterrand, à un moment qui
pourrait être perçu comme l’ultime étape de son périple.
Pour cette exposition,
comment a été pensée la scénographie ?
H.C : La scénographie de Jasmin Oezcebi et le choix des œuvres ont été pensés en osmose.
Dans l’exposition, le parcours n’obéit à aucune logique, si ce n’est celle de mettre en avant le regard
singulier de Koudelka. Sont rassemblées des images qui appartiennent à des sites différents mais qui
fonctionnent très bien ensemble formellement, esthétiquement.
Le visiteur découvre donc avant tout une installation photographique. Celle-ci mime le principe d’un site
de fouille dont un fascicule distribué à l’entrée de l’exposition livre les clés de lecture. La scénographie
alterne de grands panoramiques suspendus présentés selon une alternance de diptyques, de triptyques
et des panoramiques de plus petits formats, posés sur des socles, proches du sol, que l’on voit ainsi en
surplomb.
Un troisième niveau complète cette installation avec les panoramiques verticaux accrochés sur les
cimaises qui s’affirment comme des fenêtres sur le paysage. À la fois tellurique et aérien, cet agencement
assez spectaculaire rejoue l’idée d’un théâtre de la vision : c’est comme si le visiteur voyait les sites
antiques se déployer sous ses yeux.
Tous ces formats et ces différences de niveaux permettent de jouer avec des effets de perspective,
engagent le regard du spectateur, l’invitent à créer ses propres associations.
La série Ruines est-elle terminée ?
H.C : C’est un projet qui habite toujours Koudelka et il y aura peut-être encore quelques images mais ce
qui est certain, c’est que la majeure partie de la série a été produite. C’est pourquoi cette exposition est
exceptionnelle. Elle rend hommage à une œuvre majeure, celle de Josef Koudelka, grand photographe de
ces paysages universels qui a souhaité transmettre avec Ruines la sidération qu’il a éprouvée pendant
trente ans devant la beauté des sites antiques.
Il y a fort à parier aussi que certaines photographies de Ruines seront amenées à vivre de nouvelles vies
dans l’espace du livre, en compagnie d’autres images appartenant à des séries distinctes comme ce fut
déjà le cas dans Chaos où certaines images de Ruines se trouvaient déjà. Le récit des images complexes
et résolument polysémiques de Koudelka, ce face à face du passé et de l’avenir, de la mort et de la vie
qu’elles rejouent inlassablement, ne s’achèvera jamais tout à fait.
Entretien
avec Bernard Latarjet
administrateur culturel, commissaire de l’exposition
Quel a été votre premier contact avec le travail de Josef Koudelka et
Comment pourriez-vous définir l’homme
et son œuvre ?
B.L : J’ai rencontré l’œuvre de Koudelka à travers Les Gitans et Robert Delpire, son éditeur en France et son ami. Ces portraits d’un peuple m’avaient fait songer d’emblée au paysage. Le sens du cadre, de la composition, des perspectives et des lumières, cette science de la représentation plastique de l’espace me conduisaient à imaginer en Koudelka le paysagiste que je rencontrerais plus tard. Peu à peu, j’ai connu l’homme : comme ses Gitans, sans feu ni lieu, comme eux ermite et vagabond. Mais ce qui m’a le plus profondément marqué chez lui est sa liberté exemplaire dans son intransigeance – liberté à l’égard des autres, des pouvoirs, de tous les biens du monde ; liberté comme éthique et comme condition de l’œuvre à faire.
Comment, selon vous,
son usage du panoramique a -t-il contribué à renouveler notre vision du paysage ?
B.L : Lorsqu’avec François Hers, nous avons créé « La mission photographique de la DATAR », nous ne
cherchions pas l’enregistrement visuel – soi-disant objectif – d’une réalité des territoires de la France
mais la représentation d’une expérience artistique de ces paysages.
Nous avons proposé à Josef un travail panoramique – qu’il a d’abord refusé – car nous pensions que
Koudelka détournerait le panorama pour « produire » un paysage subjectif singulier, non « documentaire »,
alternant lointains et gros plans, ensembles et détails, verticales et horizontales, jeux d’ombres et de
formes dans une révélation porteuse de regards inédits. En ce sens, on peut dire que dans son travail, le
traitement panoramique « fabrique » du paysage bien plus qu’il ne l’analyse.
La série « Ruines » convoque les vestiges antiques mais elle nous parle aussi de notre présent et d’une
culture commune dont la Méditerranée serait le berceau.
Comment envisagez-vous cette résurgence, voire
cette part prophétique, que semble porter l’œuvre de Josef Koudelka à l’heure où sourdent des conflits dans
cette région du monde ?
B.L : La mission de la DATAR a été le début de 34 années de projets de photographies panoramiques de
territoires divers. Ils avaient en commun de marquer l’activité des hommes dans leur fin , leur abandon ou
leur fureur destructrice. Des industries du « Triangle noir » d’Europe centrale aux traces de la guerre civile
à Beyrouth, cette œuvre nouvelle de Koudelka mettait en lumière la présence de ce qui a été et qui meurt.
En 2010, Josef et moi nous sommes retrouvés à Marseille pour préparer une première présentation du
travail en cours qu’il consacrait désormais aux grands sites ruinés de l’Antiquité gréco-romaine.
Auparavant, dès le début des années 90, j’avais été frappé par l’engagement de cet européen d’un pays
sans mer, dans un interminable périple qui symbolisait à mes yeux ce que nous cherchions à mettre
en lumière dans le programme de la future capitale européenne de la culture intitulé « D’Europe et de
Méditerranée ».
Ces tableaux de ruines m’apparaissent comme l’allégorie d’une actualité dont son art restitue le sens
dans notre présent : ici, sur les bords de « la mer commune », la naissance de l’Europe, de ses valeurs
fondatrices et l’actualité des risques de leur disparition. Cette Europe des ruines, c’est celle d’Athènes,
Rome et Jérusalem où l’esprit fait dialoguer la raison et la foi, la liberté et la loi, celle dont selon Jacques
Berque « nous portons en nous les décombres amoncelés et l’inlassable espérance ». Transfigurer les
décombres en espérances, en dépit de tout : tel est le rêve que nourrissent en moi ces images.