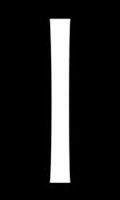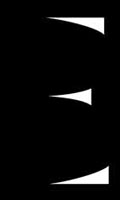Amman, Jordanie, 2012 © Josef Koudelka /Magnum Photos (1/12)
« Une odyssée panoramique »
extrait du texte d’ Héloïse Conésa, catalogue Ruines
Si on doit rapprocher le photographe d’un héros antique, il s’agirait incontestablement d’Ulysse.
Bien que Josef Koudelka écrivait dans son journal en 1974 : « il serait dangereux d’avoir un chez toi car
tu aurais envie d’y retourner », force est de constater qu’il retourne régulièrement arpenter ces sites qui
constituent d’une certaine façon son chez lui. La philosophe Barbara Cassin s’interrogeait :

AIzanoi, Turquie, 2011 © Josef Koudelka / Magnum Photos (2/12)
« La meilleure
manière d’être de retour dans la patrie, en une Odyssée transformée par le sentiment moderne, serait-ce
que ce ne soit pas la vôtre ? »
et en effet, Koudelka est bien comme Ulysse, cet exilé - ex-halos : celui qui
vient de la mer en l’occurrence de la Méditerranée- dont l’identité processuelle se construit par l’errance.
Dès lors, réaliser des photographies c’est comme dessiner une carte dont chacune des étapes scande
cette Odyssée panoramique.

Athènes, Grèce, 1994 © Josef Koudelka / Magnum Photos (3/12)
La quête commence de manière imprécise, suivant une intuition puis l’auteur crée des points de référence
avec chaque photographie. Cette carte qu’il construit n’existe pas avant de commencer le voyage, elle
naît de ses propres pas et constitue alors son Atlas particulier. Ainsi, Koudelka revient sur les sites
archéologiques à plusieurs années d’intervalle pour s’affranchir de la fascination ressentie la première fois
et proposer de ces ruines que l’on croit éternelles, une image à chaque fois différente qui en approfondira
le sens.
Durant les mois d’hiver où il ne voyage pas, il fait et défait son œuvre, constamment accroche ou
décroche du mur de son atelier ses épreuves, en revoit l’agencement afin de poursuivre sa quête de la
photographie atemporelle, celle qui résistera à son regard implacable. De même, on ne s’étonnera pas de
retrouver certaines de ses premières images panoramiques des cités gréco-romaines dans Periplanissis
en 1997, dans Chaos en 1999, puis dans Rome, théâtre du temps et enfin dans Vestiges en 2013.

Thugga, Tunisie, 2011© Josef Koudelka / Magnum Photos (4/12)
Décontextualiser et recontextualiser s’avère le propre de l’allégorie et le regard de Koudelka n’est pas
un regard qui pétrifie le paysage comme le ferait celui de la Méduse mais un regard qui transperce
les blocs de l’espace et du temps pour mieux réunir le proche et le lointain, le contemporain et le
non-contemporain.
Le choix du noir et blanc renforce la présence iconique des ruines et opère un
déplacement dans notre regard où le passé s’affirme comme site du présent et préfiguration de l’avenir.

Apollonia, Libye, 2007 © Josef Koudelka /Magnum Photos (5/12)
Ce regard se révèle empreint de sidération face à la beauté chaotique du monde. Dans chaque photographie
de Ruines pointe donc ce regard d’Ulysse, celui-là même qui donnait son titre au film de Theo Angelopoulos
dont Koudelka accompagnera par ses photographies le voyage du tournage. Ce regard c’est aussi
celui que cherche à capter Fritz Lang dans le dernier plan – panoramique – du film de Jean-Luc Godard
Le Mépris : Ulysse vu de dos, regardant lui-même Ithaque retrouvée. Chez Koudelka, la dernière image de Ruines - celle de l’ombre du photographe sur le site d’Azanoi en
Turquie, silhouette fantomatique émergeant d’un chaos de pierres semblable aux cercles de l’Enfer de
Dante - affirme l’alliance profonde et irréductible dans ses photographies panoramiques de l’évidence et
de l’énigme. Évidence de l’Histoire, énigme de la beauté.

Amman, Jordanie, 2012 © Josef Koudelka /Magnum Photos (6/12)
« Rencontre »
extrait du texte de Bernard Latarjet, catalogue Ruines

Timgad, Algérie, 2012 © Josef Koudelka /Magnum Photos (7/12)
« C’était en 1986. Nous construisions avec François Hers, « La mission photographique de la Datar »
sur la représentation des paysages de la France. À l’époque, ce fut une « première ». Une administration
non culturelle, en charge de l’aménagement du territoire, s’adressait délibérément à des créateurs, non
pour leur commander l’illustration d’un sujet, mais pour leur demander de choisir librement le thème et
les lieux d’une expérience personnelle du paysage. Nous ne cherchions pas « l’enregistrement » visuel
soi-disant objectif d’une réalité devenue peu lisible mais les regards singuliers que des artistes portaient
sur elle.
Nous connaissions les premiers panoramas que Koudelka exposa dès les années 60. Nous aimions
le traitement du paysage dans ses travaux antérieurs depuis « Les Gitans » jusqu’à « Exils » même si celui-
ci n’en était pas le sujet central. Nous admirions la rigueur artistique et éthique de sa démarche. Nous
l’avions sollicité en mettant à sa disposition un nouvel appareil de prise de vues panoramiques. Il a d’abord
refusé. Il n’avait jamais été pleinement satisfait – disait-il – des photographies de paysage réalisées
jusqu’alors.

Myra, Turquie, 2013 © Josef Koudelka /Magnum Photos (8/12)
« Les ruines émancipées, une généalogie du regard sur le passé »
extrait du texte d’Alain Schnapp, catalogue Ruines

Temple d’Apollon, Delphes, Grèce, 1991 © Josef Koudelka /Magnum Photos (9/12)
Nous l’avons convaincu d’accomplir un essai de ce nouveau matériel pendant quelques jours.
Au terme d’une semaine d’errance autour de Paris, il accepta notre offre : « Avec cet appareil, je serai
peut-être capable de faire quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant ».
C’est ainsi que commencèrent 34 années de projets successifs de photographies panoramiques de
territoires divers qui avaient tous en commun de marquer l’activité des hommes dans leur fin, leur
effondrement, leur abandon ou leur fureur destructrice. Des industries du « Triangle noir » d’Europe
centrale, aux traces de la guerre civile à Beyrouth, l’œuvre nouvelle déployait la proximité ou la présence
de ce qui a été et qui meurt.
En 2010, nous nous sommes retrouvés à Marseille pour préparer une première exposition du travail en
cours qu’il consacrait désormais aux grands sites ruinés de l’antiquité gréco-romaine.
.jpg)
Éleusis, Grèce © Josef Koudelka /Magnum Photos (10/12)
Auparavant, dès le début des années 90, j’avais été frappé par l’engagement de cet européen d’un
pays sans mer, dans un interminable périple – il dure depuis 28 ans -à travers vingt pays du pourtour
méditerranéen et plus de deux cent lieux. Cette quête était sans précédent. Nul avant lui n’avait tenté,
avec une telle opiniâtreté, sans aide financière, une exploration aussi complète des vestiges d’une grande
histoire par les moyens de l’art photographique.
Elle symbolisait à mes yeux ce que nous cherchions à
mettre en lumière dans le programme de la future capitale européenne de la culture intitulé « D’Europe et
de Méditerranée ».
Les tableaux de ruines de Koudelka m’apparaissaient comme l’allégorie d’une actualité dont son art
restituait le sens dans notre présent : ici, sur les bords de « la mer commune », l’actualité de la naissance
de l’Europe, de ses valeurs fondatrices, l’actualité des risques de leur mort.
.jpg)
Mycènes, Grèce, 2003
© Josef Koudelka /Magnum Photos (11/12)
Cette Europe des ruines,
c’ést celle où l’esprit fait dialoguer la raison et la foi, la liberté et la loi, celle dont, selon Jacques Berque
« nous portons en nous les décombres amoncelés et l’inlassable espérance » Pour entendre les ruines, il faut toujours plus d’images, toujours plus précises, plus fidèles et plus atti-
rantes. La photographie a donné l’illusion d’une accessibilité infinie aux images mais cette profusion se
fait au risque d’une perte de sens. Piranèse l’avait pressenti qui s’insurgeait contre l’obligation de pré-
cision qui s’imposait aux dessinateurs et graveurs du XVIIIe
siècle
« les ruines parlantes ont rempli mon
esprit d’images que des dessins précis ne m’auraient jamais permis d’exprimer »
.jpg)
ALeptis Magna, Libye, 2009
© Josef Koudelka /Magnum Photos (12/12)
Piranèse revendique la créativité du dessinateur et affirme sa totale liberté de choisir le cadrage et la mise
en perspective des monuments qu’il figure, il conjoint l’approche technique et savante des monuments
avec une esthétique propre à faire parler les ruines. C’est le chemin ardu que parcourt, avec son objectif,
J. Koudelka par sa maîtrise des champs de prise de vue et de la tectonique des monuments.Il combine
les vues d’ensemble et les vues rapprochées, les cadrages horizontaux et verticaux.
Ce n’est ni la facture
du monument, ni le plan de la ville qui l’intéressent mais le jeu complexe des éléments architecturaux
dans leur rapport avec la lumière. Il renoue ainsi avec les premiers dessinateurs des ruines, avant le
déferlement des images, pour qui chaque esquisse était une aventure. L’archéologie des images de Koudelka est pleinement une arkhê, un commencement, qui donne comme
le voulait Piranèse la parole aux pierres. Ses photographies redécouvrent la fascination des ruines si bien
exprimée par Diderot : « C’est que les ruines sont un lieu de péril, et que les tombeaux sont des sortes
d’asiles, c’est que l’homme s’assied où la cendre de l’homme repose ».
❮
❯