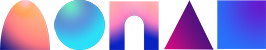
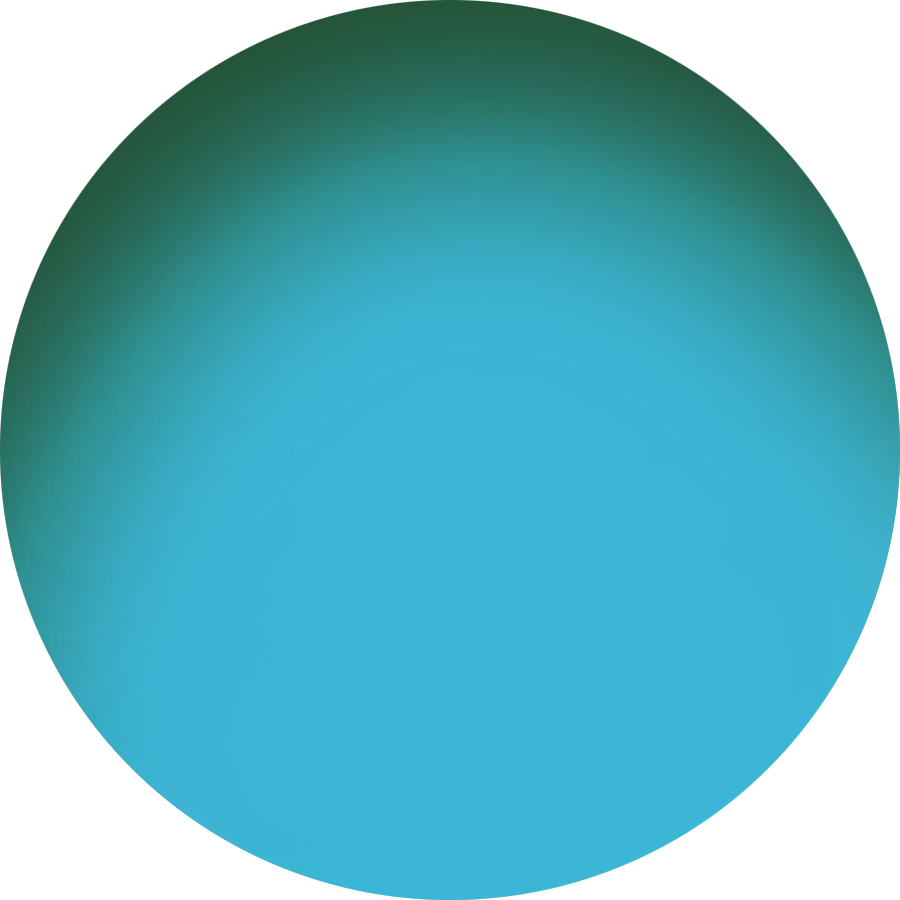
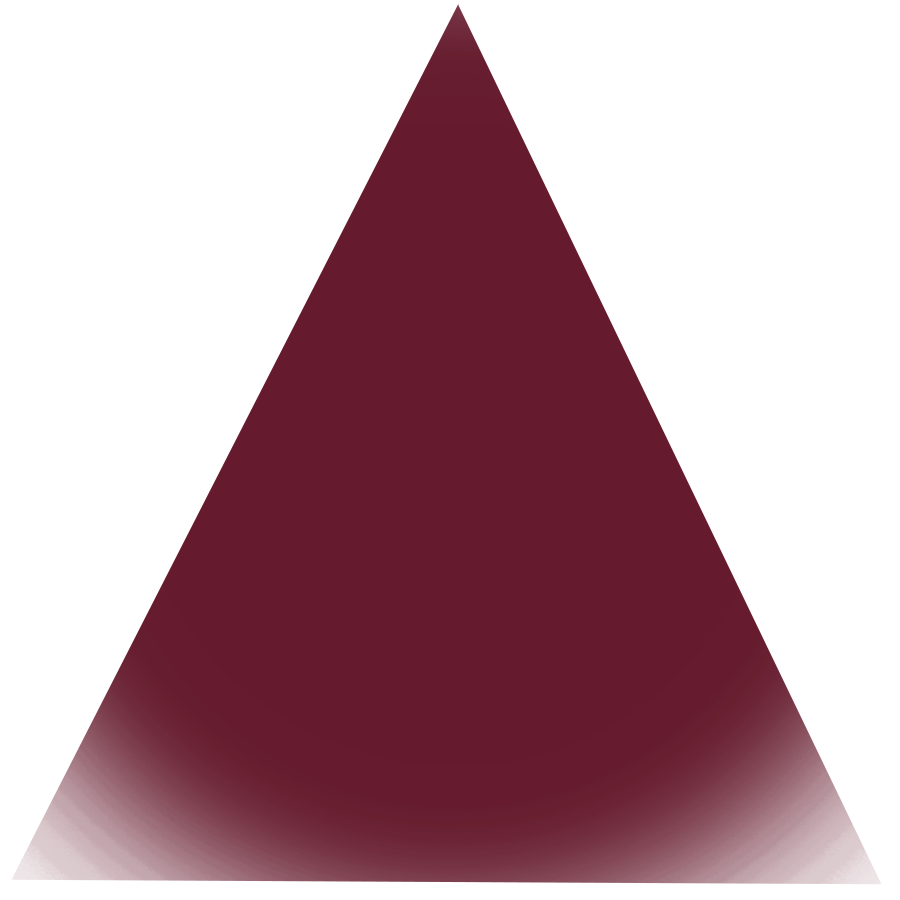
L'architecture de l'invocation
Images du pouvoir : la rhétorique visuelle de la présidence des États-Unis
Texte d’Ulrich Keller
Au cours des deux derniers siècles, le pouvoir politique aux États-Unis s’est principalement exercé par la parole, les discours véhiculés par les législateurs et les présidents faisant l’objet central du reportage politique. En vue de simplifier un sujet complexe, cet article se concentre sur le discours présidentiel comme leitmotiv illustrant la question suivante : comment la « visualisation » progressive du discours politique (c’est-à-dire sa transformation d’un genre littéraire en un genre iconographique) par les médias visuels de masse a fondamentalement changé, plus précisément comment elle est parvenue à masquer et à orienter le processus politique, et ce, bien avant l’avènement de la télévision (comme la plupart des études en la matière semblent le supposer), puisqu’elle remonte à l’apparition, près d’un siècle auparavant, des journaux illustrés, quotidiens ou hebdomadaires. L’influence considérable de la presse illustrée des débuts sur la politique américaine peut être démontrée éloquemment en comparant les événements discursifs de deux périodes historiques différentes.

Au tournant du XIXe siècle, le reportage sur le discours présidentiel constituait une affaire purement littéraire, tel qu’on peut le voir dans un journal grand format décrivant le premier discours inaugural de Thomas Jefferson, vendu dans les rues le jour de son investiture : ce qui comptait alors, c’était le verbe imprimé, pas l’apparence visuelle. Abraham Lincoln pouvait encore se permettre de porter des costumes froissés par-dessus des chemises trempées de sueur sans que cela n’affecte sa carrière. Mais avec l’apparition de la presse illustrée après la guerre de Sécession, la dimension visuelle du discours présidentiel commença à rivaliser avec son aspect littéraire. En 1907, à la tradition du discours présidentiel purement verbal et sans images, certaines publications répliquèrent par des images présidentielles sans paroles, comme l’illustre cette double page du Harper’s Weekly. Les photographies sont agencées en un discours visuel complexe qui commence par le discours d’investiture avec un portrait de face et se termine par la conclusion avec une prise de vue de dos de Roosevelt, le reste de la séquence visuelle consistant en des vues symétriques de profil se répondant. Nous avons là un des premiers exemples d’une édition illustrée de divertissement qui, au début des années 1900, commençait à générer un type nouveau de spectacle esthétique imprimé. La teneur du discours de Theodore Roosevelt documenté ici n’est pas révélée au lecteur et ne semble d’ailleurs plus être importante. Roosevelt en était conscient, et sa performance oratoire emphatique visait délibérément à séduire les appareils photo des journalistes1.
Ainsi, la presse illustrée, qui présentait visuellement et théâtralisait le discours présidentiel, incita aussi à une plus grande fréquence des discours officiels. Par exemple, durant plus d’un siècle, les messages présidentiels de la Maison-Blanche étaient transmis au Capitole sous forme écrite, jusqu’à ce que Woodrow Wilson décide de s’adresser en personne au Congrès, en une apparition sensationnelle qui visait à faire la une des journaux. Déjà quarante ans plus tôt, le démocrate Greeley avait théâtralisé sa déclaration de candidature à la présidence, dans un rituel public couvert amplement par la jeune presse illustrée, alors que les déclarations de candidature étaient faites jusque-là par courrier. Rappelons ici qu’aux débuts de la République, l’art oratoire politique était éminemment suspect et associé au spectre de la démagogie et de la subversion dictatoriale de l’État. C’est pourquoi les premiers présidents des États-Unis n’y recouraient qu’en de rares occasions, principalement dans le cadre de cérémonies inaugurales. La sollicitation de votes durant les campagnes présidentielles était considérée comme particulièrement vulgaire, et les candidats à la présidence restaient donc discrètement à la maison, sans faire parler d’eux2. Au tournant du XIXe siècle toutefois, la presse illustrée naissante, associée au reportage littéraire traditionnel, quoique modernisé, mit à la disposition des candidats occupant une fonction parmi les plus élevées du pays une machine de communication si efficace auprès des masses qu’il ne s’agissait plus de savoir si, mais plutôt comment cette machine pouvait être exploitée à des fins politiques.
La sollicitation de votes durant les campagnes présidentielles était considérée comme particulièrement vulgaire, et les candidats à la présidence restaient donc discrètement à la maison, sans faire parler d’eux
Aux fins de la présente étude qui se veut brève, nous ne retracerons pas toutes les étapes de transformation de l’instrumentalisation politique de la machine médiatique. Il suffit de dire que l’élection présidentielle de 1896 marque l’avènement de la campagne médiatique « moderne » à part entière. Alors que le candidat républicain William McKinley resta à la maison durant cette campagne, honorant ainsi la plus pure tradition de discrétion, 750 000 partisans républicains étaient acheminés à grands frais par train vers Canton (Ohio), où ils marchèrent du matin au soir pour aller congratuler le candidat chez lui. Il les reçut avec une stratégie médiatique à deux volets. D’une part, il s’adressa aux différents groupes avec des discours soigneusement préparés pour répondre aux divers intérêts régionaux et sociaux; d’autre part, ses interventions « visuelles » étaient aussi efficaces, le candidat posant avec chacune des délégations pour des « photos de famille » décontractées et rassasiant par ailleurs la presse de photos propres à la narration biographique, tandis qu’un énorme budget de campagne servait à imprimer des millions de dépliants et d’affiches aux couleurs vives.
Son opposant, William Jennings Bryan, entra dans la course avec un programme centré sur les enjeux agricoles qui lui valut l’anathème des milieux d’affaires de l’époque, ce qui le força à mener une campagne avec un maigre budget, sans financement à proprement parler. Sa situation aurait été désespérée s’il n’avait été l’un des plus grands orateurs de sa génération. Rompant brutalement avec la tradition, il décida de faire des prises de parole l’instrument principal de sa campagne et s’embarqua dans une campagne massive à coup de discours répétitifs dans tout le pays. Bryan parcourut 13 000 kilomètres, prononça 600 discours et rencontra en personne un public de cinq millions d’Américains. Les journaux ridiculisèrent son programme politique, mais partout où il allait, il faisait immédiatement sensation et des images de ses apparitions charismatiques remplissaient la une des journaux. L’exemple illustré ici est une gravure au burin inspirée du dessin d’un journaliste, ou « artiste spécial » du New York Herald. Les principaux discours de Bryan, qui étaient souvent capturés en direct par des dizaines de croquis de ce genre, présentés sur une page entière, contribuèrent grandement à l’attrait charismatique qu’il exerçait. Contrairement aux thèses dominantes, la publicité illustrée devint un incontournable aspect de la politique américaine bien avant que les illustrations photographiques en demi-teinte n’aient conquis la presse. Officiellement, Bryan maintint toujours que la campagne de 1896 s’était centrée sur les problématiques de l’époque et non sur la personnalité des candidats, mais il était suffisamment habile pour exploiter les nouvelles possibilités offertes par la presse illustrée. Son style oratoire mélodieux et bien rôdé séduisait autant l’œil que l’oreille, et même les plus petits détails de ses interventions alimentaient l’actualité en images3.
Bryan parcourut 13 000 kilomètres, prononça 600 discours et rencontra en personne un public de cinq millions d’Américains.
Alors que cette sphère émergente du spectacle politique constituait un atout promotionnel indéniable, elle présentait aussi le problème inédit jusqu’alors de contrôle du message politique. Du temps d’Abraham Lincoln et d’Andrew Jackson, c’est-à-dire aussi longtemps que la politique restait un concept littéraire, de tels problèmes ne se posaient pas vraiment4 Chaque discours était soigneusement révisé avant sa publication, parfois en s’attachant l’aide de rédacteurs professionnels, et la diffusion in extenso dans toutes les régions était garantie par les petits journaux appartenant aux partis politiques. Comme les équipes de rédaction n’existaient pas encore dans les organes de presse, il n’y avait à craindre aucune vérification critique et indépendante des faits et des antécédents; les journaux étaient certains de conspuer le dernier discours en date du parti adverse, quel que soit le contenu de celui-ci. Dès les années 1900 cependant, les journaux à grande diffusion, avec leur propre équipe de journalistes et de photographes, firent leur apparition. La presse devint un pouvoir indépendant, soumettant l’arène politique à une observation critique, de plus en plus iconographique, et forçant les hommes politiques à rivaliser pour gagner son attention, leurs principaux concurrents en la matière étant l’actualité sportive, théâtrale, et les histoires sexuelles et criminelles.
L’établissement politique répondit par sa prise en main, dans un processus interne, en coulisses, d’autocontrôle et de planification stratégique. Les candidats à la présidence commencèrent à s’adjoindre les services d’aides et de conseillers dans des arrière-salles enfumées, en vue de rendre leurs interventions sûres et attrayantes pour la presse. Bryan avait déjà eu recours à ce type d’aides en 1896, et même si les réunions stratégiques ne portaient pas sur la couverture par la presse, une photo du candidat faisait ça et là son apparition sur une page imprimée, à une période où on commençait à penser que toute publicité est une bonne publicité. Ainsi, une scission eut lieu entre Bryan, l’évangéliste charismatique et Bryan, l’homme politique habile; et cette scission devint un trait constitutif du milieu politique américain du XXe siècle. Les véritables décisions politiques étaient désormais prises en coulisses, tandis qu’une mise en scène politique soigneusement esthétisée était présentée aux appareils photo ou aux caméras. Le reportage iconographique força la politique présidentielle à avancer masquée, à se faire une façade esthétique. Il n’est pas fortuit qu’à la convention du Parti démocrate de 1896, les membres de la délégation du Nebraska marchassent dans la salle en portant la même coupe de cheveux « à la Bryan » pour attirer l’attention de la publicité visuelle, ou que le candidat McKinley, toujours tiré à quatre épingles, figurât dans des publicités pour des articles de rasage5.
Plus encore, la structure même du discours se transforma. Les discours officiels d’une durée de deux heures, chargés de contenu programmatique, firent place à des sortes de causeries informelles reprenant les paroles du président lors d’entrevues (souvent illustrées) dans la presse métropolitaine de divertissement, dynamique dans laquelle se jouait une lutte pour le pouvoir entre la presse et le milieu politique. L’innovation la plus fondamentale de l’époque consista cependant à accompagner la parole présidentielle, officielle ou non, d’un éventail d’éléments non verbaux à la rhétorique purement visuelle. Les candidats à la présidence et les présidents des États-Unis commencèrent à être principalement connus, non pour leurs paroles et leurs convictions politiques (qui continuaient bien entendu à être diffusées dans des discours officiels), mais pour les activités auxquelles ils s’adonnaient au quotidien, comme lire des livres, jouer au golf, pêcher à la truite, et ainsi de suite. Wilson fut promu de cette manière durant une campagne et gagna l’élection avec l’aide de votes aux primaires contre la classe dominante du parti6. Cet intérêt pour l’aspect humain de la présidence commença à dominer dans les journaux avec la montée du photojournalisme et peut être mieux résumé comme une victoire du sourire sur la déclaration programmatique. Jusqu’à l’époque de McKinley, il était impossible de trouver des images de présidents souriants. Theodore Roosevelt se servit de son irrépressible hilarité comme d’un outil publicitaire et très rapidement, son sourire permanent devint non seulement typique de cette fonction, mais aussi une condition sine qua non. Il n’était plus possible de gagner des élections sans maîtriser l’art de la mascarade physionomique7. S’adaptant à la technologie photographique de l’époque, de tels efforts promotionnels se contentaient de l’effet momentané des instantanés au lieu de compter sur les scénarios narratifs à long terme auxquels le public moderne de la télévision est désormais accoutumé.
... Cet intérêt pour l’aspect humain de la présidence commença à dominer dans les journaux avec la montée du photojournalisme ...
L’avènement de la bande d’actualités ne modifia guère le rythme staccato de la couverture photographique; les actualités ne montraient les présidents que dans des séquences brèves ou dans des activités cérémonielles traditionnelles (non scénarisées) et ressemblaient beaucoup à la manière dont les mêmes événements étaient couverts dans des clichés imprimés dans les journaux. Dans les années 1930, les présidents continuaient d’être préparés pour des expositions ponctuelles au feu des appareils photo et des caméras : ils souriaient, serraient des mains et coupaient des rubans de manière plus photogénique que jamais. Pendant ce temps, la réduction du discours présidentiel en unités plus petites et plus faciles à diffuser se poursuivait. En faisant abstraction de l’innovation non visuelle que constitue la diffusion radiophonique du discours présidentiel dans des formats de plus en plus informels, voire intimistes, comme dans le cas des fameuses « causeries au coin du feu » (fireside chats) de Franklin Delano Roosevelt, l’éternelle partie de bras de fer entre les tenants de la presse et les présidents concernant les règles des entrevues aboutit, sous la présidence du candidat démocrate Roosevelt, à la mise en place de conférences de presse bimensuelles. Cette institution donna à la presse un accès constant au président et conféra également à celle-ci un droit quasi constitutionnel d’examen critique des affaires politiques courantes telles que celles présentées par le président lui-même8. Justement du fait de cette institutionnalisation, aucun organe de presse important ne pouvait plus s’extraire des rituels de l’information, et cela donna à Roosevelt un levier considérable pour changer les règles, jusqu’au point d’une censure officieuse. Les journalistes qui ne respectaient pas les règles étaient exclus des conférences de presse et se voyaient nier le droit d’accompagner Roosevelt lors de ses déplacements, mettant le journal concerné dans une situation de grand désavantage par rapport à ses concurrents. C’est ainsi qu’il fut possible, par exemple, de cacher à la nation le handicap physique de son président; les médias le savaient, et quelques photographes avaient documenté son état, mais à part de rares exceptions, ces images ne furent jamais publiées dans les journaux9.
Alors que les répercussions de la bande d’actualités restèrent étonnamment modestes dans la période séparant les deux guerres mondiales, l’avènement de la télévision dans les années 1950 et son ascension depuis lors entraîna une réorganisation draconienne du traitement médiatique du discours présidentiel. Parmi les principaux changements, on compte la scénarisation du discours politique étendu et des actions du président ainsi que la convergence entre l’intérêt pour les aspects humains, la réduction du discours programmatique en format de 60 minutes, voire 30 minutes, en extraits de 10 secondes; l’élimination progressive de l’accès de la presse au président pour examen critique du gouvernement; et le fait que le contrôle visuel s’étendit de celui des acteurs politiques vers celui du public local et de la diffusion en direct devant les caméras10.
Dans ce nouvel environnement médiatique, John F. Kennedy fut de bien des manières une figure moins révolutionnaire qu’on ne pourrait le penser. Il est vrai qu’avec lui, les conférences de presse devinrent un genre télévisuel à part entière et, à la différence de son prédécesseur Adlai Stevenson, qui resta fidèle à l’écrit et à la tradition éminemment obsolète du discours formel, rédigé par lui-même et riche en contenu, Kennedy s’avéra exceller dans l’improvisation, conscient que la politique programmatique était chose du passé. Quand il annonça, dans son discours d’investiture, que « le flambeau avait été passé », il n’annonçait pas un programme politique concret, mais faisait délibérément et habilement appel à la puissance du rêve et du désir, offrant un riche sujet d’inspiration aux artistes du pop art. Rosenquist décrivit le président élu (avant son investiture), comme dans un état d’innocence, non encore terni par l’incident de la baie des Cochons, comme un avenir pur et un rêve de consommation, tandis que Rauschenberg rendait hommage à la mémoire du président comme emblème d’un passé pur et légende populaire, héros de la dernière frontière imaginaire de l’espace11. Entre ces deux évocations, respectivement prospective et rétrospective, la place de la politique réelle reste vide. Ce fut là un des premiers moments de l’histoire où des observateurs critiques suggèrent la perte d’un référent, ouvrant la voie à une manipulation de plus en plus effrénée des signes politiques.
Le Kennedy véritable, celui qui œuvra durant le millier de jours qui sépare ces deux images était, en fin de compte, un libéral qui considérait encore que les médias étaient au moins le pouvoir quasi constitutionnel qu’ils devinrent sous Roosevelt. Il divertit, séduisit et jouta avec les journalistes, comme le firent Wilson et les deux présidents Roosevelt avant lui. Pour lui, les médias imprimés et télévisuels restèrent un pouvoir indépendant et opposé à respecter et à persuader. Mais une telle séparation entre l’action politique et l’investigation journalistique tourna rapidement en un vœu pieux du passé, comme Carry Winogrand le souligna dans des instantanés intelligents qui constituent en eux-mêmes une petite théorie de la communication de masse dans les années 1960. Dans une photographie du discours d’acceptation de Kennedy en 1960 au Memorial Coliseum de Los Angeles, le candidat élu du Parti démocrate s’adresse directement à la forêt de caméras, occultant ainsi le public pourtant présent sur place. À l’avant, Kennedy s’adresse à la foule et aux journalistes lui faisant face, mais derrière lui se trouvent des chargés de communication qui observent, surveillent et contrôlent l’image télévisée de Kennedy.
L’écran de télévision devint la mesure de toute chose politique, et la nécessité d’une performance efficace à l’écran imposa une symbiose de plus en plus étroite, bien qu’opaque, entre les acteurs politiques et les équipes de cameramen. Au cours du processus, toute interaction directe, spontanée ou personnelle entre le candidat et les gens était également perdue. Alors que Bryan avait dû se déplacer durant des mois pour donner des centaines d’allocutions et s’adresser en personne à cinq millions d’Américains, Kennedy put atteindre des dizaines de millions de personnes en une soirée, quitte à réduire le public présent sur place à une simple fonction décorative au profit du grand spectacle télévisuel orchestré dans des salles de régie. De telles salles se transformèrent en une zone nébuleuse où les médias pouvaient détourner la politique et où les hommes politiques pouvaient manipuler les médias. Winogrand illustre cette première idée dans son cliché des manifestations contre la guerre du Vietnam, où il est impossible de distinguer les manifestants soi-disant passionnés des représentants des médias présumés impartiaux et objectifs; il est évident que les appareils photo et les caméras ont tout autant fabriqué cet événement qu’ils l’ont immortalisé. Cependant, si la presse détourna ici le processus politique, c’est le modèle de manipulation de la presse par les hommes politiques qui s’avère historiquement dominant, et le perfectionnement de cette technique n’est dû à nul autre que Richard Nixon.
Déjà à la fin des années 1950, Nixon faisait un usage magistral des caméras de la presse en écrasant Khrouchtchev lors de la fameuse émission télévisée Kitchen Debate. Il ne s’agissait pas d’un exemple de journalisme critique. La caméra était habilement employée comme complice d’une embuscade politique. Plus tard, Nixon, le président, écrivit les scénarios de couvertures narratives entières pour la télévision, y compris celui de sa démission et depuis, une telle scénarisation devint la norme. Également en tant que président, Nixon abolit les conférences de presse régulières et réduisit souvent ses interactions avec les médias à la lecture de messages de 60 secondes qui ne pouvaient pas être retouchés et devaient être diffusés dans leur intégralité ou pas du tout. Nixon fut ainsi un pionnier en matière de politique à coup de petites phrases et accéléra l’érosion de la presse de l’époque du Vietnam en tant que pouvoir indépendant et critique. Durant la campagne de 1968, Nixon devint essentiellement son propre producteur d’émissions télévisées en achetant des plages d’écoute de 60 minutes pour de fortes sommes, avec des vidéos « d’actualité » enregistrées par sa propre équipe de cameramen. De tels dossiers de presse comprenaient des billets pour des débats locaux avec des panélistes choisis par l’entourage de Nixon, tandis que les membres de la presse de campagne étaient parqués dans une salle adjacente, d’où ils pouvaient voir l’écran, mais ne pouvaient ni témoigner en direct de l’événement ni poser leurs propres questions à Nixon12.
... on sait que chaque fois que Nixon apparaissait à la télévision, ses spécialistes des médias surveillaient les accès du studio et refusaient l’entrée à tout partisan dont l’apparence n’était pas à leur goût ...
Manifestement, l’équilibre entre l’action politique et le reportage journalistique fut réagencé ici à l’avantage flagrant de la première : les hommes politiques commencèrent à produire leur propre couverture télévisée, gagnant toujours plus de contrôle sur la machine médiatique et même sur leur public – un élément particulièrement nouveau. En ce qui concerne le contrôle visuel du public, on sait que chaque fois que Nixon apparaissait à la télévision, ses spécialistes des médias surveillaient les accès du studio et refusaient l’entrée à tout partisan dont l’apparence n’était pas à leur goût, en particulier ceux qui avaient la peau foncée ou les cheveux longs. Cela n’est pas toujours facile à documenter avec des images, mais une comparaison entre les conventions respectivement démocrate et républicaine de 1968 est suffisamment éloquente. De la convention démocrate à Chicago, on possède des images de presse qui ressemblent à celles de Winogrand, mais en couleurs, et qui prouvent que personne ne surveillait l’entrée des lieux pour empêcher l’accès aux personnes « basanées ». Du côté de Nixon par contre, cet événement fut traité comme l’agréable fin de semaine à Miami d’une famille américaine modèle, heureuse et irréprochable13.
Pour approfondir l’étude de ce nouvel art du contrôle du public, considérons ceci : les cérémonies d’investiture du XIXe siècle arboraient défilés, encouragements partisans et liesse populaire autour de la tribune présidentielle. Pourtant, au moment de l’investiture de Lyndon Baines Johnson en 1965, il était déjà coutumier de construire des enceintes pour contenir tous les spectateurs en un seul endroit et contrôler ainsi totalement l’image. Il est à noter que les groupes, parmi le public, qui se trouvaient assis dans les rangées en contrebas et face à la tribune présidentielle étaient forcés de tourner le dos à la cérémonie d’investiture, regardant plutôt les caméras de télévision, pour un meilleur effet esthétique. Un tel style de reportage visait le contrôle total : non seulement les acteurs politiques commencèrent à produire leurs propres émissions, ne laissant aux sociétés médiatiques commerciales soi-disant indépendantes que le seul choix de livrer à la nation un dossier de presse prêt à l’emploi, mais avec la complicité de l’appareil médiatique, l’établissement politique commença à nier au public médiatisé par voie électronique toute réaction indépendante ou critique. Le public local, préparé pour l’effet esthétique devant les caméras, symbolisait la nation tout entière et reflétait pour elle devant les écrans de télévision la docilité avec laquelle il était prévu que ces événements télévisés soient contemplés : comme un spectacle éblouissant à sens unique. Bill Clinton s’avéra particulièrement maître dans l’art d’insérer la performance politique dans des formats de débats télévisés durant lesquels le public symbolique applaudissait à la demande, soit à l’instigation d’un télésouffleur électronique, soit par réflexe conditionné14.


